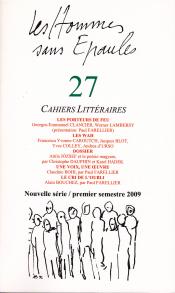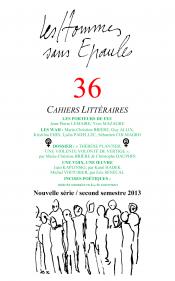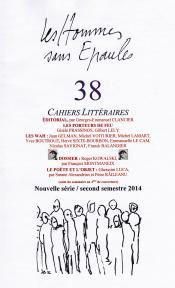Georges-Emmanuel CLANCIER

Légende (photographie de Philippe Delaveau) : Georges-Emmanuel Clancier et Christophe Dauphin, à Valvins, dans le jardin de Stéphane Mallarmé, le 24 septembre 2013.
HOMMAGE A GEORGES-EMMANUEL CLANCIER
par Christophe DAUPHIN
Poète, romancier, critique ; notre cher GEC est, on le sait, l’auteur d’une œuvre considérable. En fiction, la trilogie du Pain noir, certes, mais pas seulement, car c’est bien la poésie qui d’un bout à l’autre innerve, habite sa vie comme son œuvre, qui est l’une des plus importantes de sa génération, laquelle ne fut pas avare de talents. Il en fut très tôt l’un de fleurons.
Un mois avant son cent-deuxième anniversaire, Georges-Emmanuel Clancier a fait paraître chez Albin Michel, Le temps d’apprendre à vivre, Mémoires 1935-1947 ; livre au sein duquel GEC repasse une nouvelle fois au crible sa vie de jeune homme. Il s’agit du quatrième tome de ses livres autobiographiques, après L’Enfant double (1984), L’Écolier des rêves (1986) et Un jeune homme au secret (1989). Le temps d’apprendre à vivre (titre tiré d’un vers d’Aragon : Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard) couvre la période 1935-1947. Du No pasarán ! de la guerre d’Espagne aux prémices de la guerre froide, la guerre perpétuelle est bien la toile de fond du récit, au sein duquel le poète nous entraîne en sa compagnie, en celle de ses amis et d’Anne (décédée en 2014 à l’âge de cent un ans), sa future épouse, au gré de leurs rencontres, de leurs espoirs, de leur intense force de vie. Robert Margerit, Jean Blanzat (l’aîné et complice limousin, le maître à penser), le peintre Lucien Coutaud, Joë Bousquet, Louis Aragon, Raymond Queneau, Michel Leiris, Claude Roy, Pierre Seghers, Pierre Emmanuel, Max-Pol Fouchet, et tant d’autres encore, membres et acteurs d’une génération dont GEC écrit qu’elle lui apparaissait soumise à deux forces contraires. Celle de « l’enthousiasme d’une jeunesse qui attestait que la poésie, comme le voulait Rimbaud, vînt changer la vie » ; celle de la « chute de l’Europe dans la criminalité mortelle, représentée par les nations totalitaires. »
On l’aura compris, cette période de 1935-1947, que GEC nomme « mes années d’apprentissages », est marquée par les évènements majeurs et tragiques de l’histoire contemporaine, laquelle dépasse sa propre histoire personnelle ; ou plutôt, laquelle se mêle étroitement à son histoire personnelle, tant GEC fut est et demeurera avant tout un Poète de la poésie vécue : « Je suis persuadé que la poésie est la tentative et la possibilité d’approche musicale au plus près de la totalité de l’être humain. Il existe tellement de voix et de voies, de possibilités d’émerveillement ressenti et actif que la poésie, par la voix/voie du langage, du chant et du souffle, constitue la meilleure route vers cet épanouissement du maximum de nos possibilités. Il s’agit d’une tâche politique, éthique et esthétique, d’une globalité existentielle. Il est un grand danger dans l’exercice de la poésie, c’est la complaisance à soi-même. Le poète peut se griser, se leurrer. La poésie peut l’enchanter trop facilement et d’une manière illusoire. Il est pris entre deux pôles : trop de lucidité l’assèche ; la complaisance l’invite à se leurrer. Le mot parfois n’est qu’un mot et il ne faut pas extrapoler. La poésie peut facilement tomber dans le simulacre, même sans que le poète le sache. Le poète, comme l’homme, doit se méfier de lui-même. »
Il est donc impossible de faire une seule lecture unilatérale de ce temps d’apprendre à vivre, qui, passionnant livre de mémoires, contenant bien des passages poignants (sur Joë Bousquet, entre autres), est tout autant un livre d’Histoire éclairé, une chronique des plus avisées de la poésie française ; un livre de poète : « Mais qu’aurais-je appris de la vie au terme de mes années de pneumothorax, sinon que l’existence était façon de mieux ou mal respirer le temps qui file ? Ou, autrement dit, de lutter contre l’intrusion en soi de la mort au point d’avoir l’illusion d’en avoir triomphé, illusion que dissiperont bien sûr les années du grand – ou plutôt du très grand – âge, mais je ne saurais trop dire depuis quand et comment le temps d’apprendre à vivre était insidieusement devenu le temps d’apprendre à mourir. Qu’apprenais-je encore, sinon que les forces de mort qu’il fallait vaincre en soi, se déployaient simultanément dans l’Histoire en train de se faire et mettaient à mal ce que notre jeunesse avait imaginé comme un temps de promesse faite à l’homme par l’homme, comme un accès à un juste bonheur. » Un pur bonheur de lecture et d’émotion. Moment d’histoire et manifeste pour le futur.
GEC est le poète d’un siècle, au sein duquel, la guerre fut un fait marquant. Il l’est hélas toujour : « Pour nous tous, poètes, qui sommes nés entre 1914 et 1919, la guerre fut un fait marquant. Nous avions tous un père qui se battait sur le front. J’en ai conçu très tôt un rejet de l’histoire, qui n’est qu’une succession de crimes et d’infamies. Bien avant que je sois né, on avait rêvé d’un monde nouveau qui irait de mieux en mieux. Lors de ma seconde naissance, à l’adolescence, me fiant à la puissance de l’art et de la poésie, j’ai pensé, avec une certaine euphorie, de l’enthousiasme en tout cas, entre la promesse rimbaldienne et les relents de surréalisme, que l’homme était en bonne voie. Et puis est venue la guerre d’Espagne. Quand ils ont tué Lorca, cela a sonné pour moi le glas. »
GEC est l’un des Porteurs de Feu des Hommes sans Epaules, un éminent Passager du temps, pour paraphraser l’un de ses propres titres, qui nous dit : « J’écris en sachant que la mort peut frapper à n’importe quel moment. Je m’y prépare sans crainte. D’autant que je ne crois pas en Dieu. Si d’ailleurs il existait, ce serait le diable. »
L’immeuble qu’il habite est situé entre le Palais de Chaillot et le Musée Guimet, dans une rue tranquille du seizième arrondissement parisien. Au rez-de-chaussée, la porte s’ouvrait sur Georges-Emmanuel. Avenant et souriant, humble et attentif, il précédait toujours son hôte en s’excusant du désordre. L’appartement est une caverne aux merveilles. Du parquet au plafond, des piles de livres, dossiers, papiers, photos, occupent tout l’espace des pièces, ne dégageant qu’un petit couloir qui permet d’atteindre le bureau de GEC, véritable antre poétique : « J’habite ici depuis cinquante ans, et je soupçonne certains de ces cartons d’être posés là, provisoirement, depuis mon emménagement, en 1958 ! », dit-il, non sans humour. Ici, le passé et le présent font plus que bon ménage : ils ont fusionné. « Je sais, disait le poète, lorsqu’il montrait les piles de livres et de papier, je devrais confier tout ça à la BnF ou à l’Imec, mais je manque de temps pour m’en occuper. En revanche, j’ai déjà préparé ma dernière demeure. Ce sera au cimetière Montparnasse, dans une tombe sur laquelle sera gravée, en guise d’épitaphe, un distique tiré d'un de mes poèmes : Nous qui sommes trace éphémère - Dans la merveille et dans l’effroi. Il paraît que l’allée est très bien fréquentée et que je ne serai pas loin de Beckett. »
Georges-Emmanuel Clancier est né à Limoges le 3 mai 1914 dans une qui résume les deux grands pôles de son Limousin intime : le pôle lumineux, Saint-Yrieix, terre de la porcelaine, par sa lignée maternelle ; le pôle ténébreux, Châlus, le pays des Clancier, artisans.
À sept ans, l’enfant - qui se partage entre l’univers petit-bourgeois de ses parents et le monde ouvrier de ses aïeuls, très tôt sensibilisé à l’injustice sociale qui frappe les gens du peuple -, entreprend d’apprendre à lire à sa grand-mère et y parvient. La maladie l’oblige, en 1931, à interrompre ses études en classe de philosophie au lycée de Limoges. En terminale, la tuberculose le confine dans une longue quarantaine. Pendant quatre ans, GEC occupe son temps à dévorer des livres (« Je n’étais pas un lecteur précoce mais je fus un adolescent boulimique. Plus tard, après ma journée de travail, j’attrapais un texte au hasard, c’était comme une bouffée d’oxygène »), et à écrire : Ma vie qui serait de semer des verbes - De glaner des images, d’égrener des mots - De labourer les sombres terres du rêve. Dès 1933, collabore à des revues, dont Les Cahiers du Sud. Il reprend des études à la Faculté des Lettres de Poitiers, puis à celle de Toulouse. Il rencontre en 1935 et épouse en 1939 Anne Marie Yvonne Gravelat, étudiante en médecine. Il vient en 1939 à Paris, où sa femme prépare l’internat des hôpitaux psychiatriques. Elle deviendra la psychanalyste Anne Clancier et lui donnera deux enfants : Sylvestre et Juliette.
En 1940, GEC entre au comité de rédaction de la revue Fontaine, dirigée à Alger par Max-Pol Fouchet. Il rencontre, ceux qui seront les amis d’une vie, notamment Raymond Queneau, Michel Leiris, Claude Roy, Pierre Seghers, Loys Masson, Pierre Emmanuel et Max-Pol Fouchet. Ajoutons André Frénaud et Jean Tardieu.
De 1942 à 1944 il recueille et transmet clandestinement à Alger les textes des écrivains de la Résistance. À la Libération, journaliste au Populaire du Centre, il dirige les programmes de Radio-Limoges. Avec Robert Margerit et René Rougerie, il fonde la revue Centres, puis dirige, chez Rougerie, une collection de poèmes manuscrits, Poésie et critique. Il est appelé en 1955 à Paris pour être secrétaire général des comités de programmation de la RTF, puis de l’ORTF, jusqu’en 1975 : « L’état poétique ressemble à l’état amoureux ; on a l’impression d’un monde plus beau, rénové. Il en est de même pour la lecture des poèmes. Quand je travaillais beaucoup à l’O.R.T.F. et que je revenais le soir accablé de fatigue, je prenais un livre au hasard dans la bibliothèque et je lisais ne serait-ce qu’un seul vers, qui m’était un ressourcement. Je trouvais là la vraie vie. On devrait même enseigner cela comme une hygiène d’existence. »
En 1956 paraît le premier tome de sa célèbre suite romanesque, Le Pain noir ; soit une saga de quatre livres qui retrace l’histoire d’une famille très pauvre dans une ferme limousine entre la fin du XIXème siècle et le début de la Grande guerre. L’histoire s’inspire largement de celle de sa famille maternelle, autour du personnage de sa grand-mère, paysanne illettrée : « J’étais heureux de pouvoir lui rendre, dans le miroir des mots, le reflet d'une enfance que ses récits, jadis, quand j'avais cinq ans, dix ans, avaient indissolublement enlacée à la mienne. »
Le Pain noir ; cet ensemble de plus de deux mille pages développe la relation de l’écrivain avec la mémoire, l’autobiographie et l’imaginaire. « Le Pain noir me ramène très loin en arrière, rapporte GEC, et les souvenirs ne sont pas les miens mais ceux de mes ancêtres. » Une deuxième trilogie, Un enfant dans le siècle, composée de trois récits (L’Enfant double, L’Ecolier des rêves, Un jeune homme au secret) suivis d’un superbe roman L'Eternité plus un jour, prolongent sa traversée du XXe siècle.
Georges-Emmanuel Clancier est poète et il est romancier ; et, dans chacun de ces deux visages, toujours au plein sens du terme, comme l’a écrit Paul Farellier, comme écrit encore (in Les Hommes sans Epaules n°27, 2009) : « Le poème semble naître chez lui comme une récapitulation totale de notre terre et de notre humanité, pour combler ce vide que le temps creuse entre l’homme et le monde, et pour conquérir une autre présence. Toutes les ressources de la parole sont mobilisées pour épouser le monde, en dénoncer souvent l’inacceptable, en déchiffrer les brûlantes énigmes. Cette œuvre, une des plus considérables de ce temps, aura marqué chacun d’entre nous. Elle fait définitivement partie de notre patrimoine poétique. »
Georges-Emmanuel analyse dans La Poésie et ses environs ce qui distingue et rassemble ces deux formes de création : il y voit « les deux faces d’une même tentative ou tentation de l’homme de vaincre le temps, la mort, de susciter un objet qui les intègre et les dépasse ». Mais l’une et l’autre s’enracinent dans ce temps de façons toutes différentes. « Le roman, écrit-il, sauve la vie non pas en l'arrachant au temps mais, au contraire, en rendant sensible le mouvement du temps à travers une vie. » Complémentairement, « le poème est négation du temps, exaltation de l’instant rendu immobile et illimité, telle une image microscopique de l’éternité... qui ne cesse de jaillir hors du temps ou, plus exactement, au-dessus du temps, comme l’île est au-dessus de la mer ». Si l’œuvre romanesque de Clancier est en effet placée sous le signe de la reconquête patiente du temps passé, c’est au contraire sous celui de l’instant que ses poèmes tentent de reconnaître d’autres pouvoirs du langage. Lors de la publication de Terres de mémoire, il confie son espoir « d’engager la poésie sur les routes en croix ou mieux : en étoile, du langage », c'est-à-dire, acceptant le risque de s’égarer en refusant ainsi une seule orientation, « de traquer et d’édifier le poème à tous les niveaux du langage ».
Au poète et au conteur, il convient d’ajouter le critique avisé de La poésie et ses environs, du Panorama, Panorama critique de la poésie française de Rimbaud au surréalisme, et Panorama critique de la poésie française de Chénier à Baudelaire, Seghers, 1953 et 1963) et d’autant plus, que la critique, en poésie, aujourd’hui, a quasiment disparu au profit du simple commentaire plus ou moins complaisant. Où sont les GEC, les Sabatier, les Brindeau, les Breton, les Rousselot d’aujourd’hui ? Il faut aussi ajouter, ce qui est peut-être le plus important : cette adéquation totale de GEC avec son œuvre ; du poète qui ne fait qu’un avec son poème. Ce poète, le poème est son regard et ses mots l’habillent. Ce poète n’a jamais été un doreur de pilule, ni un rêveur en chambre, mais toujours un catalyseur, un semeur d’identité. Évidences (Mercure de France, 1960), que GEC m’adressa en 1994, me procura davantage qu’un plaisir de lecture, mais l’exigence et le Feu (« Le poème est fait de mots accolés les uns aux autres. Qu’importe le mot s’il n’est qu’un mot, s’il n’est chargé de la source et de l’origine ? »), c’est-à-dire la force et j’y reviens.
Notre cher GEC est décédé mercredi 4 juillet 2018, à 6h, à l'âge de cent quatre ans.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
*
Mercredi 30 avril 2014, l’Académie Mallarmé et la Société des Gens de Lettres co-organisaient un Hommage au poète Georges-Emmanuel Clancier, à l’occasion de son centenaire, à l’Hôtel de Massa (Paris 14). Nous pûmes ainsi écouter, dans une salle archi-comble (près de 140 personnes, jusque dans l’escalier), les témoignages et lectures de Jean Claude Bologne, François Montmaneix, Jean Orizet, Lionel Ray, Jean Portante, Vénus Khoury-Ghata, Richard Rognet, Gabrielle Althen, Claudine Helft, en présence de Georges-Emmanuel Clancier.
Éluard parlait d’Une leçon de morale. GEC fut, pour sa part, époustouflant, et donna, sans le vouloir, une leçon d’humilité et de profondeur : c’est-à-dire de poésie. Non, le Vivre en poésie ne saurait être assimilé à une pose, à un jeu linguistique dans lequel l’être profond n’est pas engagé. Ce fondamental fut rappelé, il me semble, avec force, par GEC, ce mercredi, en présence de deux TV (France 3 et Web Télé Culture). Georges-Emmanuel Clancier fut par la suite l’invité de l’émission littéraire (le seul poète à n’avoir jamais été invité dans cette émission ; et encore, ce ne fut bien sûr pas pour sa poésie) La Grande Librairie, jeudi 22 mai 2014, sur France 5.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
*
GEORGES-EMMANUEL CLANCIER, LE « PRINCE RIEUR »
par Jean ORIZET
Dès l’enfance, je suis tombé dans le chaudron – ou plutôt l’athanor – de la poésie. Un grand-oncle instituteur ne fut pas étranger à l’affaire : il me faisait apprendre par cœur des poèmes du répertoire classique, en bon « hussard noir » qu’il était. Cet exercice de récitation a gravé de manière indélébile en ma mémoire, nombre de poèmes et de fables que je récite encore, tant d’années après.
Adolescent, je vivais loin de Paris, dans ma campagne bourguignonne, où j’avais le plus grand mal à me procurer en librairie, recueils de poèmes et anthologies. Dans les années cinquante – soixante, je me constituai, peu à peu, une bibliothèque dans laquelle figuraient les ouvrages des grands aînés, de la génération de mon père nés entre 1907 et 1925. Ces aînés avaient nom : Georges-Emmanuel Clancier, Eugène Guillevic, Alain Bosquet, Max-Pol Fouchet, Luc Bérimont, Marcel Béalu, Charles le Quintrec, Pierre Seghers, René Tavernier, Pierre Emmanuel, Robert Sabatier, Jean Tardieu, Julien Gracq, Jean Rousselot.
Ils étaient hommes de radio, journalistes, éditeurs, animateurs de revues, professeurs et je ne pouvais guère imaginer alors, qu’ils deviendraient tous des amis chers. À partir des années soixante-dix, le rêve se fit réalité. Au moment où j’écris ces lignes, des quatorze poètes cités, le seul survivant est Georges-Emmanuel Clancier. Il va fêter, en 2014, son centième anniversaire, et nous serons nombreux à le célébrer. Grâce à G.E.C. – c’est ainsi que l’appellent ses amis. - Je découvris, dans mes jeunes années, le fameux Panorama de la poésie française de Rimbaud au Surréalisme, paru aux éditions Seghers en 1953. J’en fis mon miel, et ce livre m’accompagnera tout au long de mon parcours.
À partir des années 80, nos chemins ne cesseront de se croiser, Georges-Emmanuel et moi. Au P.E.N. Club d’abord, dont GEC devint le président en 1976, fonction à laquelle je lui succèderai en 1993, après avoir été secrétaire général sous les présidences de René Tavernier et de Solange Fasquelle. A l’académie Mallarmé, ensuite, dont il fut un des membres refondateurs. J’y serai élu en 1981. Nous participerons ensemble à de nombreux jury de poésie, dont celui du prix Max Jacob.
Dans les Congrès du PEN Club international auxquels nous participions, GEC et moi, j’étais chaque fois étonné par la capacité qu’avait notre ami à s’esquiver à un moment ou à un autre de la journée, pour aller découvrir les merveilles de la ville qui nous accueillait : Prague, Saint-Jacques de Compostelle, Cambridge ou Lugano.
En 1985, Georges-Emmanuel publia, dans la collection Poésie/Gallimard, Le Paysan céleste, qui rassemblait une quintessence de son oeuvre poétique. Je rendis compte de ce livre dans Le Figaro Magazine, en précisant que l’adjectif céleste devait être pris, moins dans son acception purement religieuse que dans une dimension orphique et sacrée, traduite par un chant des éléments naturels – le ciel, le soleil où le pré – le pré surtout, dont Clancier parlait dans un poème intitulé Avènement publié en 1942, en pleine guerre, dans le numéro spécial de la revue Fontaine fondée par Max Pol Fouchet, le fameux De la poésie comme exercice spirituel.
Voici ce magnifique poème en prose, art dans lequel GEC est passé maître : « Un après-midi de juin, j’étais assis près d’une mince rivière. Le pré était fauché. Je voulus noter quelques mots sur cette herbe rompue, et d’eux, s’élevait un ordre qui s’étendait à la terre, à mon sang. L’ordre de ma vie. La plénitude du nom. Comme si, quelque puissance me prenait, qui lentement s’était édifiée en moi, comme si elle me prenait et me menait au-delà de mon ombre, juste à cette herbe d’abord, puis à tout ce qui n’est plus terrestre, mais visage de la terre ».
« Prince rieur au plus fort du carnage » le centenaire Clancier nous donne, par sa vie et son œuvre, une magnifique leçon de courage et d’espoir.
Jean ORIZET
(Revue Les Hommes sans Epaules).
*
À PROPOS DE PASSAGERS DU TEMPS, DE GEORGES-EMMANUEL CLANCIER
par Lionel RAY
( ..) Je vous ai lu, Georges-Emmanuel Clancier, comme on le fait j’imagine assez rarement : poème après poème, dans l’ordre, de l’ouverture qui est méditation sur le temps, c’est-à-dire sur le passage, à la clausule qui nous fait, après navigation aventureuse, après le périple « à travers temps à travers lieux / parmi les ombres et leurs désordre », toucher terre ou plutôt y revenir… si étrange est l’impression que nous laisse un livre qui s’achève – et embarqués nous y étions tous, poète-narrateur, héros personnel du poème et nous lecteurs, « passagers de l’onde passagère » dites-vous, descendant ce courant de mémoire pour aboutir à l’adieu final : « Et puis adieu carnage adieu folie adieu / géhenne adieu misère adieu merveille ». Adieu dont on sait bien qu’il n’est pas définitif puisque le livre de bord de votre navigation est là, tout chargé de lueurs, de peines et de joies, et l’on peut y revenir et refaire avec vous un bout de chemin, certes ce n’est qu’un chemin de mots ici tracé, mais c’est votre chemin que nous empruntons et qui devient un peu le nôtre, vers la géhenne vers la merveille.
Je voudrais dire quelques mots de l’architecture du livre, elle n’est en rien laissée au hasard. Enfances, Solstices d’Eros, La promesse, Passage d’Orphée, Jeune, immense mère, De Naguère à ce jour : ces titres indiquent autant d’étapes successives, les grands moments tels qu’ils se présentent dans le cours ordinaire de l’existence. Et si l’on entre dans le détail de la vie de l’enfant du Limousin, de l’écolier, du jeune homme à la découverte de l’amour, de la poésie, des poètes etc., on observe que tout cela est agencé avec beaucoup de rigueur. Comme les pierres d’une voûte, il est impossible de déplacer les poèmes qui sont là où ils doivent être. On se gardera donc de lire aucun d’entre eux sans le rapporter aux autres, à ses voisins proches ou éloignés, chacun servant à l’autre de préparation ou de conclusion, d’appui ou de contre-appui. Tout est ici reprise, écho, prolongement comme dans un oratorio. Ce qui imprime au livre un rythme particulier, une structure dynamique.
Vous avez, poète, multiplié de vous-même les images dans un jeu frémissant et mobile. Ici rien n’est fixe et rien n’est simple. Votre poésie est tout entière mouvement ou plutôt passage comme le titre le suggère. Rien d’immobile, tout est voué à l’écoulement, à la transformation, et souvent à la perte. Image de la vie elle-même. En même temps, poésie de la transcendance et de la mort, elle nous place sur un seuil d’inquiétude, nous laissant deviner la grande énigme, l’au-delà indéchiffrable. Puis il arrive qu’elle s’efface, poésie du prosaïque quotidien, elle se fait quasiment prose quelquefois, elle peut tout dire, s’emparant de toute chose. La vie est là. Mais la mort aussi qui creuse ce livre si plein. Ainsi sommes-nous conduits de la terre maternelle d’où procède la vie à la tombe immense où tout aboutit et qui est la Terre encore, la même, la Terre-mère, ventre de vie et lieu de mort. Mais si tout est passage, traversée, il se pourrait que le terme n’en soit pas un, qu’il n’y ait pas de fin qui soit au sens strict du mot une fin. La poésie n’est tout à fait elle-même que lorsqu’elle ne s’arrête et ne conclut. Et lorsque tout est dit selon les mots commence un monde selon le rêve qui est le monde plus vrai, plus réel que celui de l’insuffisante réalité, d’au-delà du vieux pays de châtaigniers et de fougères que vous célébrez – qui est ce pays même et qui ne l’est pas tant il est plus que lui : la chose vue, entendue, mémorisée, continue d’exister au-delà des limites du sensible. Aussi est-ce pour éternellement que la poésie dit l’éphémère, le passager, le transitoire. Tant de scènes ici évoquées, de gestes qui eurent autrefois dans l’enfance buissonnière leur importance, leur charge d’émotion, tant de paroles perdues qui ne le sont pas, ne le sont plus pour celui qui en recueille et en prolonge l’écho, pour celui qui replace de telles scènes, de telles émotions qu’on pouvait croire éteintes dans l’ordre de la mémoire vive par la grâce des mots. Alors ce qu’on croyait à jamais perdu, abandonné au chaos est pour toujours renaissant, dans la fraîcheur toujours nouvelle d ‘une « poussée d’églantines » et la vie ici réapparue, même fragile, même sur le point de s’évanouir, se concentre et s’intensifie : les mots se dressent dans le chant de leur sens, odorants et colorés, les scènes d’autrefois, telle figure entrevue un été au bord de la mer, le frère de sang avec qui vous jouiez è la flibuste à Saint-Georges de Didonne, telle autre scène de braconnage ou de chasse enfantine, telles amours fraîches comme filles de mai, tel ami de guerre clandestine et de poésie au vieux pays troubadour amoureux des batailles, et la mère-enfant et le père, homme de silence et de courage, tout cela, ce monde total qui composait la trame des jours anciens soudain ré-apparaît, resurgit dans la lumière heureuse des églantines, les mots sont une offrande à ce qui fut, c’est le bouquet d’images du temps retrouvé.
(..) Le temps, ce temps dont nous sommes les passagers donne lieu à quelques représentations remarquables. En quelque sorte visualisé et visible puisque reflété au miroir de la nuit, autrement dit du sommeil et du rêve, ou de la mémoire dont on sait qu’elle est oublieuse, il est aussi conçu charnellement et spirituellement dans d’intimes correspondances, le poète peut alors évoquer « la charnelle éternité du regard » ou percevoir « la même éternité dans l’écoute du grillon ». Ailleurs le mouvement du temps devient poids et poids qui accable, « tortue très lente très sage / Pesante pierre » ou le voici arrêté, matérialisé, pétrifié même de façon très négative cette fois et spleenétique et c’est « Parmi les pierres, les tonnes pourries du temps ». L’image telle que la pratique Georges-Emmanuel Clancier n’est pas sans rappeler l’univers et la vision des poètes baroques qu’il affectionne, lorsqu’elle dit par exemple « ce ruissellement illimité d’hommes et de femmes » dont le poète se veut (l’) « étincelle, écume, onde passagère ». Voici encore l’aventure d’écrire comme navigation, les mots après un périple en mer rejoignant le silence, leur port d’attache, faisant place à la nuit qui « s’étend et s’épanche », à l’écriture nocturne, au songe hors du temps et du lieu…Baroque tout aussi bien cette évocation qui dit le mouvement, le scintillement et l’arabesque :
« Écrit mobile de l’ombre et de l’été
Respiration de l’arbre et du soleil
Trace, figure, silence
Scintillement de l’être
Vagues, brises, poussent les mots
Et quelle arabesque conquérante… »
Autant d’images qui donnent à l’instant fugitif, à ce qui est mobile, furtif et précaire, l’apparence sinon la consistance d’un absolu. Un monde comme rafraîchi nous est alors offert et qui pourrait bien être celui des réalités essentielles. Il constitue notre lieu authentique, notre séjour d’élection, où la vie prend sens autrement, la « vraie vie » qui hors du poème est « absente » selon Rimbaud.
(..) Dans le récitatif comme dans les séquences en contrepoint, plus brèves, plus déliées, plus aériennes, signalées en italiques, ce qui m’intéresse toujours davantage à chaque lecture et c’est tout aussi évident dans l’admirable dernier livre Contre-chants, ce n’est pas tant que l’oratorio soit composé de souvenirs de la vie réelle, ce ne sont pas les ciels du Limousin ou les forêts de châtaigniers, ni les sources, ni la rêverie près des gisants, ni tel jeu d’enfance avec l’escouade garçonnière, ni la fraîcheur des amours, ni la chaleur des amitiés ( Seghers, Emmanuel, Loys Masson, Claude Roy et tant d’autres) mais c’est, au-delà des matins et des soirs, tout l’inexprimé qui circule entre les mots, ce qui étonne au détour d’un vers, tout ce qui nous dispose à une lecture intériorisée, ce qui affleure au ras des phrases. Ce n’est pas dit et c’est là, le paysage lyrique (pas le discours) est le lieu d’une grâce qui est au-delà de la formulation, c’est ce qui nous place dans le sillage des oiseaux, ce qui nous embarque – je cite – sur « le navire des nuées, compagnon du bouvreuil et du chardonneret, entre somme et songe ».
Dans cet indéfinissable au-delà, notre plaisir est fait d’un trouble mystérieux, irréductible au sens, c’est quelque chose de vague et d’obsédant comme peuvent l’être certaines figures de rêve entrevues dans la brume du réveil et qui presque effacées persistent néanmoins, c’est le rêve d’un rêve, entre les mots, entre les mondes, c’est tout l’inexprimé qui irradie, le foyer secret du sens, le sens qui déborde.
Ainsi va la poésie de Georges-Emmanuel Clancier, comme un toucher de rêve. Ainsi à chacune de ses étapes faut-il que la vie du poète (parfois inscrite et confondue avec la marée de l’Histoire) aboutisse à un livre. S’agit-il d’ailleurs d’un aboutissement ? Plutôt d’un témoignage qui montre au miroir des mots par fragments une réalité en voie de disparition, et que le poème reconstitue défiant l’absence ou la perte, fabriquant de la présence avec des « débris d’univers », avec des aubes évanouies, des formes qui sont à peine plus que « parcelles fuyantes d’un songe », entre nuit et jour, entre veille et sommeil, entre rêve et conscience, pétales persistants d’un bouquet qui flambe dans la brume, dans la mémoire douce-amère, l’oublieuse mais aussi la foisonnante, la flamboyante mémoire.
Lionel RAY
(Revue Les Hommes sans Epaules).
*
GEORGES-EMMANUEL CLANCIER, LE PASSAGER DU SIÈCLE
par Jean PORTANTE
Je ne sais pas si le XXe siècle s’est clos avec la chute du mur de Berlin ou s’il a duré jusqu’à celle des tours de Manhattan, ce qu’en revanche je sais, c’est qu’il a commencé en 1914, quand, mus par une ferveur, incompréhensible de nos jours, Allemands et Français se sont précipités dans la première grande boucherie du siècle, enterrant à jamais ce que Stefan Zweig appelait le monde d’hier. Or, c’est exactement sur cette ligne de faille entre deux mondes, en 1914, qu’est né George Emmanuel Clancier, et aujourd’hui, alors que sans doute nous sommes à la veille d’une nouvelle ligne de faille, il est encore là, parmi nous, avec, en lui, la longue expérience du Passager du siècle.
Mais tout comme Zweig et bien d’autres, il a voulu comprendre ce qui a amené le genre humain vers la ligne de faille séparant le monde d’hier de celui d’aujourd’hui, le comprendre non en feuilletant seulement les livres d’histoire qui relatent et décontextualisent souvent les grands événements, mais en remontant l’arbre généalogique jusqu’à sa grand-mère et plus loin encore. Cela a donné naissance à une suite romanesque poignante dont le titre à lui seul suffit pour dire qu’elle est ancrée dans le peuple et relate la vie dure menée par les gens simples pendant le monde d’hier.
Je parle des quatre tomes du roman Le Pain noir, chers amis. Ceci pour nous rappeler en passant que GEC est autant sinon plus romancier que poète, ce qui n’est pas une injure. Il y aussi, dans son œuvre, la nouvelle, le conte, le théâtre, l’essai, le journalisme, bref tout ce qui fait partie de l’écriture. GEC est un écrivain. Un écrivain qui, pour se dire ou pour dire le monde qui l’entoure ou pour dire ce qui ne se voit plus aujourd’hui, choisit tantôt le roman tantôt la poésie, comme si l’un ou l’autre n’y arrivait pas à lui seul.
Le Pain noir, donc. Ce long roman évoquant le monde d’hier. Un monde où une famille, les Charron, est prise dans l’engrenage des événements qui vont de la guerre de 1870 à celle de 14, puis de là jusque dans les années Trente et même au-delà. Un monde en pleine mutation industrielle qui transforme brutalement les paysans en ouvriers et détricote les liens humains et sociaux que des siècles entiers ont péniblement tissés. C’est l’éclosion des usines, la porcelaine dans ce cas-ci, puisqu’on est à Limoges, la naissance de ces usines, inaugurant une nouvelle ère, mais qui, nous le savons, mettront moins d’un siècle plus tard la clé sous la porte, répondant à une nouvelle mutation encore en cours aujourd’hui et qui de nouveau frappe de plein fouet les générations actuelles des couches populaires. C’est cela qui donne au Pain noir une actualité qu’il ne souhaiterait pas connaître de la sorte, puisque celui qui a écrit le livre, je veux dire, celui qui dans le roman l’écrit, à savoir Pierre, le petit-fils de l’héroïne de l’histoire qu’est Catherine Charron, le fait quelque part dans les années 50, au moment, reconstruction d’après-guerre oblige, où le pays s’apprête enfin à vivre les trente glorieuses et où rien n’indique encore que l’ère industrielle avance lentement non vers son paroxysme mais vers sa fin.
Cela confère au lecteur d’aujourd’hui du Pain noir un statut spécial et l’on comprend pourquoi tant de téléspectateurs ont, entre décembre 1974 et février 1975, suivi avec impatience les huit épisodes du film que Serge Moati a tiré des quatre tomes du roman. On en était alors à la première secousse du séisme social qui allait s’abattre sur nos contrées et qui aujourd’hui éclate au grand jour. Le Pain noir, en prenant le parti de raconter l’histoire par les gens de la France d’en bas, en nous faisant suivre l’itinéraire d’une fillette qui, enfant encore, est contrainte de travailler comme la plupart des fillettes de l’époque, afin que la famille ne meure pas de faim, fillette mûrissant en se frottant à la vie et aux événements de son temps, traversant les calamités de son temps sans courber l’échine, nous confronte, nous qui nous trouvons de l’autre côté du temps, à la leçon de la fragilité de la vie, de la courte durée des cycles, de la dure marche des choses, avec ses petits bonheurs et ses grandes détresses, que, générations de l’après, nous avons tendance à oublier.
Le roman prend ainsi des allures de ce que les Allemands appellent Bildungsroman – pour lequel, soit dit entre parenthèses, le français a dû forger deux termes Roman de formation et Roman d’apprentissage –, mais il est en même temps une grande saga familiale qui, de l’aveu même de GEC, est celle de la sienne. Un hommage donc à cette grand-mère, Marie-Louise ayant pris les traits de Catherine, qui a résisté contre vents et marées et permis à ses descendants, dont deux sont présents ici, Georges Emmanuel et Sylvestre, de connaître une vie meilleure. GEC ne cache pas dans son roman tout ce qu’il lui doit. Et si c’est à elle qu’il le dédie, elle « sans qui ce livre n’aurait pas été écrit », comme il le dit dès le premier tome, dans le dernier il raconte, dans une scène émouvante entre Catherine entrée dans sa dernière saison et son petit-fils Pierre entouré de ses deux enfants Sylvie et Gérard, comment le roman est né et quel lien la réalité peut avoir avec la fiction. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce dialogue entre la grand-mère et son petit-fils devenu écrivain. Citation : La dernière saison, pages 375 à 377.
On a là, chers amis, la définition même du roman. De la réalité mêlée à de la fiction, sans qu’on sache où finit l’une et où commence l’autre. Mais attention, le mélange ne fonctionne que si le tout débouche dans le vrai. Et nul doute, avec son pendule oscillant entre faits réels et invention, Le pain noir entre dans la vérité de la vie.
Jean PORTANTE
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Œuvres de Georges-Emmanuel Clancier
Poésie : Temps des héros, Cahiers de l'École de Rochefort, 1943. Le Paysan céleste, Robert Laffont, 1943. Journal parlé, Rougerie, 1949. Terre secrète, Seghers, 1951. L'Autre rive, Rougerie, 1952. Vrai visage, Seghers, 1953; Robert Laffont, 1965. Une Voix, Gallimard (prix Artaud 1957). Évidences, Mercure de France, 1960. Terres de Mémoire, Robert Laffont, 1965. Le Siècle et l'espace, Marc Pessein, 1970. Peut-être une demeure, précédé d'Écriture des jours, Gallimard, 1972. Le Voyage analogique, Jean Briance, 1976. Oscillante parole, Gallimard, 1978. Mots de l'Aspre, Georges Badin, 1980. Le Poème hanté, Gallimard, 1983. Le Paysan céleste, suivi de Chansons sur porcelaine, Notre temps, Écriture des jours, Poésie /Gallimard, 1984. L'Orée, Euroeditor, 1987. Tentative d'un cadastre amoureux, Écrits des Forges, 1989. Passagers du temps, Gallimard, 1991. Contre-Chants, Gallimard, 2001. Terres de mémoire suivi de Vrai visage, La Table Ronde, coll. poche La Petite vermillon, 2003, Le Paysan céleste - Notre part d'or et d'ombre (poèmes 1950-2000), préface d'André Dhôtel, Poésie/Gallimard, 2008. Vive fut l'aventure, Gallimard, 2008.
Romans : Quadrille sur la tour, Edmond Charlot, 1942 ; rééd. Mercure de France 1963. La Couronne de vie, Edmond Charlot, 1946. Dernière heure, Gallimard, 1951; Éditions du Rocher, 1998. Le Pain noir (I), Robert Laffont, 1956. La Fabrique du roi (II), Robert Laffont, 1957. Les Drapeaux de la ville (III), Robert Laffont, 1959. La Dernière Saison (IV), Robert Laffont, 1961. Les Incertains, Seghers, 1965; Robert Laffont, 1970. L'Éternité plus un jour, Robert Laffont, 1969; La Table Ronde, 2005. La Halte dans l'été, Robert Laffont, 1976. Le Pain noir, La Fabrique du roi, tome I, Les Drapeaux de la ville, La dernière saison, tome II, Robert Laffont, 1991. Une Ombre Sarrasine, Albin Michel, 1996.
Nouvelles et contes : La Couleuvre du dimanche, Méditerranea, 1937. Le Parti des enfants, Fayard, 1957. Le Baptême, Fayard, 1959. Les Arènes de Vérone, Robert Laffont, 1964. L'Enfant de neige, Casterman, 1978. L'Enfant qui prenait le vent, Casterman, 1984.
Autobiographie : Ces ombres qui m'éclairent : L'Enfant double, Albin Michel, 1984. L'Écolier des rêves, Albin Michel, 1986. Un Jeune Homme au secret, Albin Michel, 1989. Le Temps d'apprendre à vivre, Albin Michel, 2016
Ouvrages critiques : André Frénaud, Poètes d'aujourd'hui, Seghers, 1953. Panorama critique de la poésie française de Rimbaud au surréalisme, Seghers, 1953. Panorama critique de la poésie française de Chénier à Baudelaire, Seghers, 1963. La Poésie et ses environs, Gallimard, 1973. Dans l'aventure du langage, Presses Universitaires de France, 1987. La Vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle, Hachette, 1977. La Vie quotidienne en Limousin au XIXe siècle, avec la collaboration de Pierre-Sylvestre Clancier, France Loisirs, 1992. Le Passant de Vérone, Éditions du Rocher, 2001. Le Roussillon, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, 1988. Limousin, Terre secrète, Renaissance du Livre, 1999 L'Oiseleur pris au Piège : Comédie en 4 Actes, Le Bruit des Autres, 2006.
Entretien de Bernard Lehut (RTL) avec Georges-Emmanuel Clancier à l'occasion de la sortie de son livre de Mémoires 1935-1947 Le Temps d'apprendre à vivre (éditions Albin Michel) :
Portrait de Georges-Emmanuel Clancier. Emission “Sur les docks”, France Culture, 29 avril 2013.
Georges-Emmanuel Clancier, Passager du temps. Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, 2013.
Lecture de Georges-Emmanuel Clancier, en 2011.
Rencontre avec Georges-Emmanuel Clancier. Observatoire de la Diversité Culturelle, 2009.